Gardons-nous du tout numérique, stopcovid l’appli de trop !
Dans la crise que nous traversons, si les enjeux sanitaires, sociaux et économiques sont à l’épicentre, les outils numériques sont souvent en première ligne et nous mettent en contradiction sur plusieurs points. L’ampleur des usages numériques ne peut occulter les limites de ces outils.
Les outils numériques accroissent les inégalités sociales et ne peuvent remplacer l’école
La fermeture des écoles et des lieux de formation a vu la mise en place de dispositifs d’apprentissage en ligne, via internet, pour permettre une continuité scolaire et éducative, l’école à la maison ou la formation à distance. Certains s’en sont emparés avec enthousiasme, en appui sur des discours technophiles, relayés par des plateformes commerciales très intéressées financièrement. Mais la réalité a mis aussi en lumière les limites de l’immédiateté du « tout numérique ». La machine ne peut remplacer les interactions sociales. Les contenus en ligne doivent être pensés dans des scénarios pédagogiques intégrant de la coopération, de l’alternance de situations cognitives différentes. Les inégalités sociales face à l’information et aux connaissances ont explosé : inégalités d’équipement ou d’accès au réseau, mais aussi différences dans la disponibilité et la capacité des parents à accompagner leurs enfants, du fait de leurs propres conceptions des activités scolaires et des activités numériques.
Le nécessaire soutien à l’audiovisuel public et à l’information journalistique indépendante
Les plateformes numériques sont de précieux moyens de rester en relation, de se parler, de se voir, d’échanger images et vidéos, de donner l’illusion d’être ensemble. Elles constituent, du fait du confinement de la population, une alternative à l’absence d’interactions physiques. Mais pendant cette période de confinement de la moitié de l’humanité, les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) et autres NATU (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) continuent de monétiser nos usages et nos données, en y trouvant une manne de profits toujours plus élevés. Ils renforcent leur collecte de données et leur situation de monopole, secteur d’activité par secteur d’activité, sans contribuer de façon juste aux budgets des Etats. En outre Google et Facebook en particulier, via leurs médias sociaux propriétaires (YouTube, Instagram, WhatsApp…) renforcent leur position dans l’accès à l’information, à sa production et à
sa circulation. Il est plus que jamais nécessaire de soutenir l’audiovisuel public et la production d’une information indépendante et éditorialisée. France télévisions a bien compris l’intérêt de renforcer l’offre éducative en ces temps de mise en difficulté du service public de l’éducation.
L’appli Covid : une menace pour les libertés fondamentales
Pour résoudre la crise sanitaire et relancer l’économie le plus rapidement possible, le gouvernement propose une application mobile, Applicovid, destinée à tracer les citoyens grâce aux « suivis de contacts », assurant le pistage des personnes susceptibles d’être contaminées. Le numérique nous aiderait ainsi, à sortir du confinement en améliorant la sécurité sanitaire. Cette application disposerait de toutes les données des usagers et de leurs contacts et nous pouvons être inquiets des usages qui pourraient en être faits au détriment des libertés constitutionnelles.
Conscients de la contradiction et des risques de cette proposition, ses défenseurs mettent en avant les garde-fous technologiques et juridiques qu’il faudrait lui apporter, en matière de protection de la vie privée, de consentement volontaire, de transparence du code informatique des algorithmes supports et de limitation temporelle du recueil des données en jeu, particulièrement sensibles.
De nombreuses questions restent cependant en suspens. Les enfants et les mineurs seraient-ils concernés par un tel dispositif ? N’ouvre-t-on pas la porte à l’obligation de ne se déplacer qu’avec son smartphone, obligation qui serait une atteinte fondamentale à nos libertés ?
Une vigilance et une réflexion critique vis-à-vis de nos usages du numérique, conformément aux acquis de l’éducation critique aux médias et à l’information, s’imposent d’urgence !
Nous demandons de surseoir immédiatement à la mise en place de cette application….
– Parce que son efficacité est loin d’être prouvée (risque d’un seuil d’utilisation trop faible, nombres d’incertitudes techniques et logicielles, contre effets face aux mesures de protection…).
– Parce qu’elle pose des questions de libertés individuelles et collectives et qu’elle s’inscrit dans une approche purement sécuritaire.
– Parce que le libre choix sera une illusion face à la pression sociale et la capacité des industries à la vendre, voire à l’imposer.
– Parce qu’il ne faut pas qu’une telle incitation encourage la précocité de l’équipement des enfants.
– Parce qu’il faut plutôt renforcer, en y consacrant prioritairement les moyens financiers et industriels, les tests de dépistages, l’accès aux masques et autres supports physiques de protection.
Cette vision de la sécurité favorise l’émergence d’une « société du contrôle » au détriment du développement d’une solidarité authentique. Elle risque d’entraîner la suspicion, le rejet de l’autre, la discrimination. Acteurs du monde de l’éducation, de la recherche, des sciences humaines et des sciences sociales, nous souhaitons lui opposer une approche qui privilégie résolument l’intégrité de l’information, la responsabilité individuelle et collective, fondements d’une société de la confiance et du partage.
Aujourd’hui en pleine crise, demain pour en sortir et après-demain pour refonder un futur durable, l’éducation à la solidarité active, la formation à la pensée critique des enfants et des jeunes, de tous les citoyens et toutes les citoyennes, sont et seront les piliers de notre manière de « faire société » et de notre démocratie. C’est dans le creuset de ces valeurs, que nous devons construire des réponses. La technologie y a toute sa place si elle est maîtrisée et au service de nos droits fondamentaux.
Le 22 avril 2020
A l’initiative du Comité Enfants et Écrans
Le Comité enfants et écrans rassemble des chercheurs, des enseignants, des militants associatifs de l’éducation aux médias et à l’information, des professionnels de l’enfance, des pédopsychiatres, préoccupés de construire une relation critique et réflexive aux écrans médiatiques.
Claude ALLARD, pédopsychiatre, Les désarrois de l’enfant numérique, Paris, Hermann, 2019.
Elisabeth BATON-HERVE, docteure en sciences de l’information et de la communication, Consultante et formatrice Parents, enfants et médias, Grandir avec les écrans ? Ce qu’en disent les professionnels de l’enfance, Toulouse, Erès, 2020.
Laurence CORROY, MCF HDR Université Paris 3, laboratoire CERLIS, Education et médias : la créativité à l’ère du numérique, ISTE ed., 2016.
Valérie-Inès DE LA VILLE Pr. Université de Poitiers, Directrice du Centre euro-péen des produits de l’enfant.
Eric FAVEY, Vice-Président du Collectif Enjeux e-média, ancien Président de la Ligue de l’Enseignement.
Christian GAUTELLIER, Directeur national des Ceméa en charge des pôles Culture et Médias, directeur du festival international du film d’éducation, Président du
Collectif Enjeux e-médias.
Sophie JEHEL, MCF Université Paris 8, Laboratoire CEMTI, en codirection avec Alexandra Saemmer, Education critique aux médias et à l’information, presses de l’ENSSIB 2020.
Christine MENZAGHI, co-responsable de nombreux projets d’éducation aux mé-dias et à l’information, secrétaire générale du Collectif Enjeux e-médias.
Philippe MEIRIEU, Professeur émérite en sciences de l’éducation à l’université Lumière-Lyon 2
Alexandra SAEMMER, Pr, Université Paris 8, Laboratoire CEMTI, Rhétorique du texte numérique. Figures de la lecture, anticipation d’e-pratique, Presses de l’ENSSIB, 2015.
Avec le soutien des Ceméa, du Collectif Enjeux e-médias, de la FCPE, de la FESPI (Fédération des établissements scolaires publics innovants), de l’ICEM et de l’association ALERTE écrans.
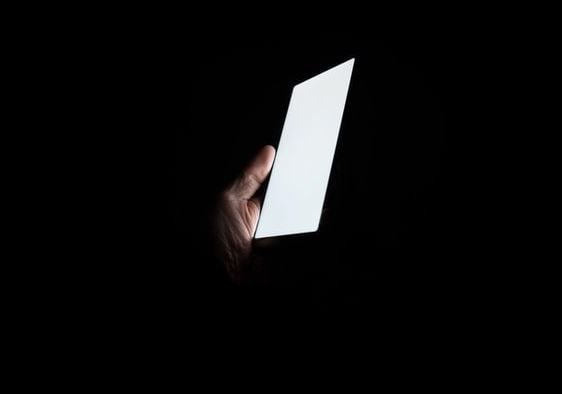
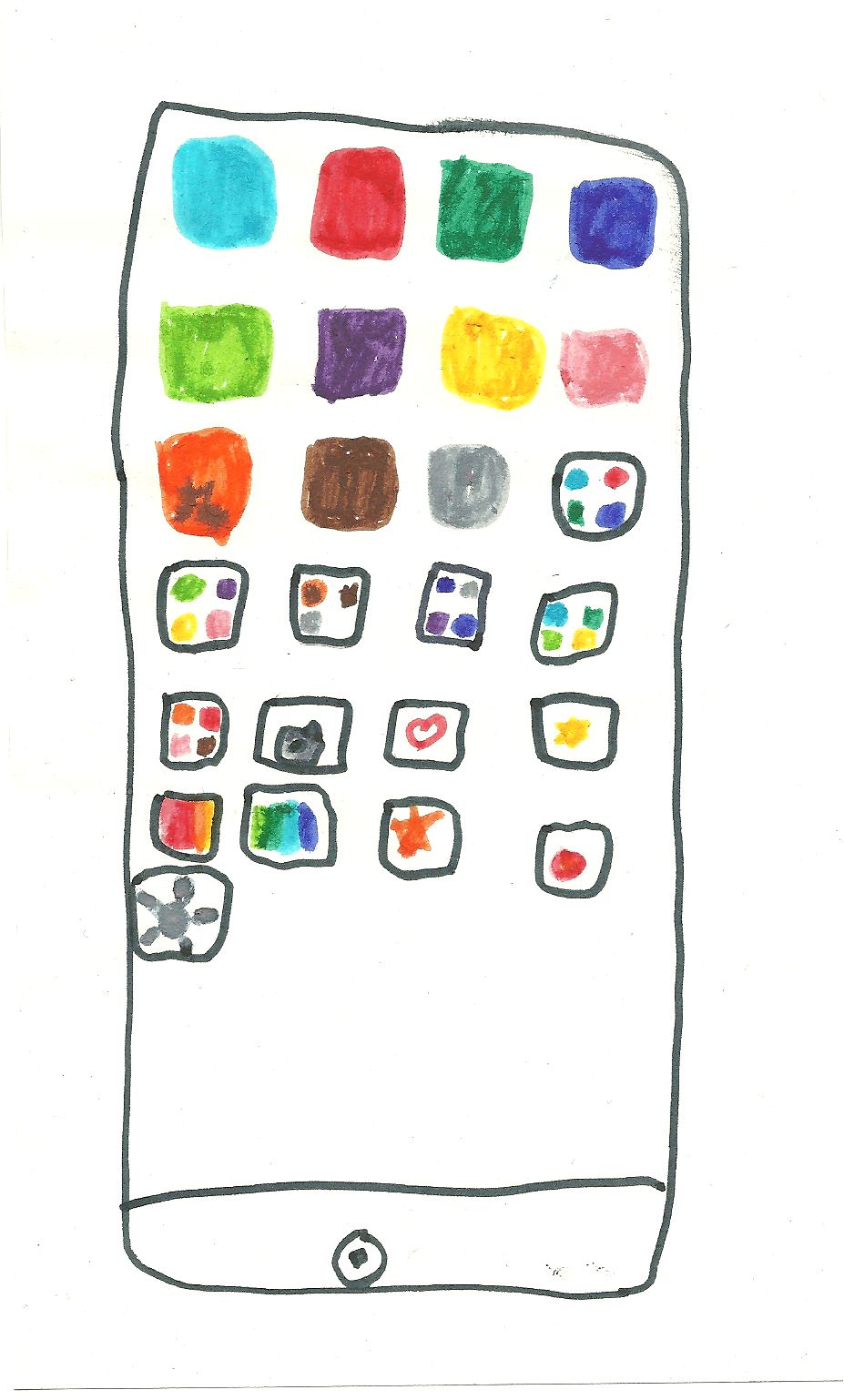
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.